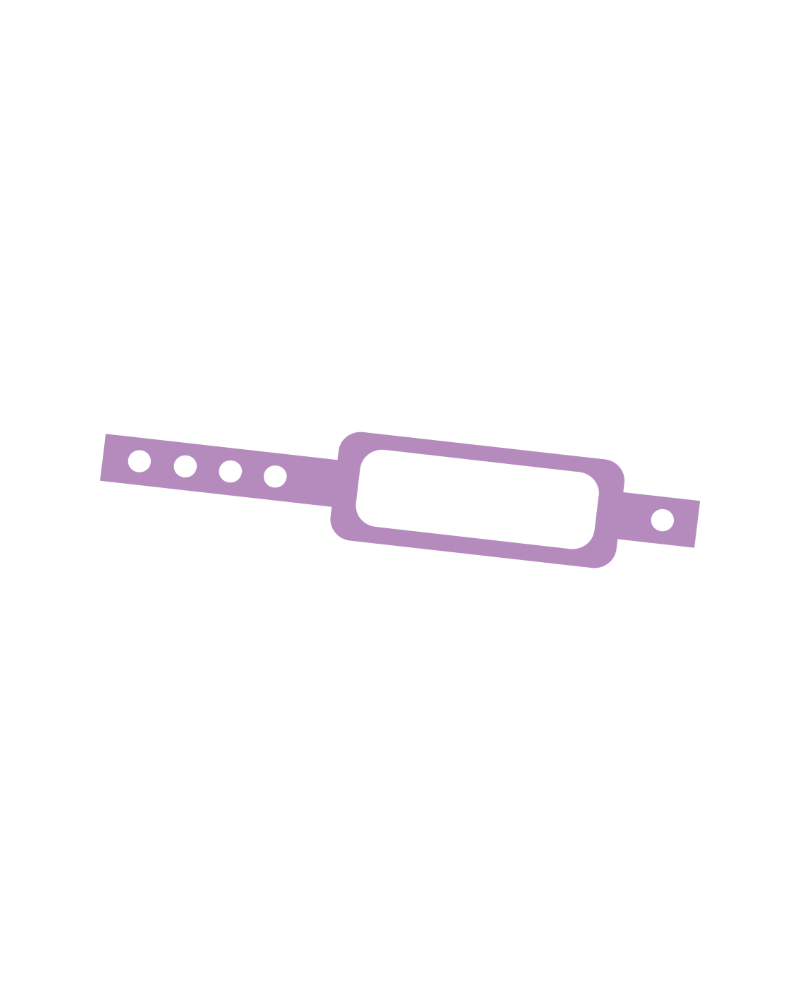
Identitovigilance
Retrouvez un ensemble d’actions et de ressources essentielles pour mener à bien une politique d’identitovigilance dans votre institution. Que vous cherchiez à standardiser le processus d’identification du bénéficiaire de soins en assurant leur implication, à gérer les erreurs d’identité entre doublons, fusions, etc., ou encore à améliorer les compétences des professionnels – cette ressource vous apporte des réponses à ces questions ainsi que bien d’autres éléments.
Vous avez besoin de vous connecter à votre compte (ou d'en créer un) ainsi que de demander l'accès au cours via le bouton à gauche en dessous de l'image.
| Responsable | Laure Istas |
|---|---|
| Dernière mise à jour | 26/11/2024 |
| Temps d'achèvement | 1 heure 50 minutes |
| Membres | 28 |
Partager ce cours
Partager le lien
Partager sur les réseaux sociaux
Partager par email
Veuillez s'inscrire afin de partager ce Identitovigilance par email.
1. Structuration de l'identitovigilance institutionnelle
Voir tout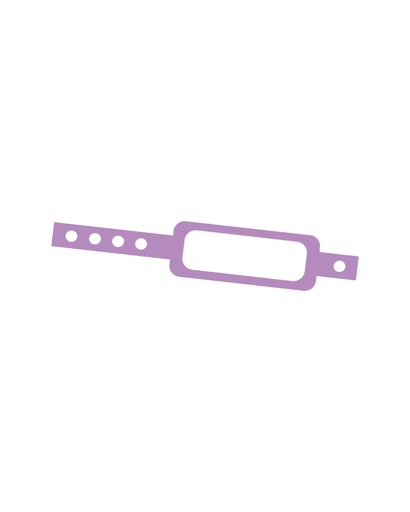
La réalisation d’un état des lieux ou une auto-évaluation constitue un préalable à une meilleure identification du patient au sein de votre établissement. Nous vous proposons dans le document ci-dessus de réaliser cet état des lieux autour de deux volets : organisationnel et technique. Grâce à cette analyse, vous pourrez décrire l’existant et envisager les actions permettant d’améliorer l’identitovigilance.
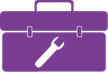
Ressource :
Le document repris ci-dessus vous permet de réaliser un état des lieux
Analyse risque
Le parcours de soins d’un patient, de l'admission à la sortie, présente plusieurs étapes critiques. Une gestion proactive de ces risques est essentielle pour garantir la sécurité des soins. Dès l’admission, la création de l’identité du patient est primordiale pour éviter toute erreur future. Dans le service, l'installation du patient, les prescriptions et les soins sont assurés par les soignants, et demandent des échanges d'informations rigoureux. Ensuite, les laboratoires et la pharmacie restituent les résultats d'examens et délivrent des médicaments, ce qui nécessite une identification précise. Le transport du patient vers le plateau technique pour des interventions représente une autre étape à risque, notamment en raison des multiples intervenants. Enfin, lors de la sortie, le dossier doit être correctement conservé et les informations administratives bien gérées pour assurer une continuité des soins.
Les principales situations de vulnérabilité sont l’identification à l’admission, les actes à risque (comme les chirurgies et transfusions), l’intervention d'équipes extérieures et l'absence de participation active des patients. À cela s’ajoutent des risques liés à des barrières institutionnelles (politiques, culture, confidentialité), à l’organisation (pratiques et points d’accueil), à l’environnement de travail (urgences, interruptions, conditions de nuit), ainsi qu’aux soignants eux-mêmes (inattention, erreurs d'identification) et aux patients (confusion, barrière linguistique, absence de pièce d'identité).
Uniformisation du processus d'identification = politique d’identitovigilance
Sur la base de l’état des lieux et de l’analyse de risque de la gestion des identités mené préalablement, l’établissement définit sa politique. La politique d’identitovigilance définit les choix institutionnels concernant les règles d'identification du patient dans le système d'information hospitalier, l'organisation et les moyens mis en œuvre dans l'établissement pour fiabiliser l’identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge.
La politique d’identification doit décrire :
· Les professionnels concernés (administratifs, soignants, médecins)
· Le management mis en place (instances, compositions, missions)
· Les caractéristiques d’identité utilisées (nom, prénom, sexe, etc.), et leurs règles de saisie
· Les procédures définies (création d’identité, signalement d’anomalies ou d’erreurs, contrôle de la validité des identités et qualité des bases)
· La gestion des étiquettes
· Les modalités d’accès aux identités
· Les moyens techniques associés
· L’implication du personnel et du patient
· Le suivi associé : indicateurs, tableau de bord
Cette politique doit être formalisée (charte d'identification du patient, procédure générale...). Par ailleurs, cette politique doit prendre compte les deux phases de l’identification du patient : l’identification primaire et l’identification secondaire.
L'identification primaire aussi appelée « administrative » ou « initiale » consiste à rechercher, créer, valider et qualifier l’identité d’un patient. Cela inclut également le traitement des doublons et des collisions d'identités, ainsi que le rapprochement des dossiers multiples appartenant à un même patient. Ce processus repose sur des procédures strictes et l'habilitation des utilisateurs en fonction de leurs cas d’usage.
L'identification secondaire consiste en une procédure de vérification de l’identité du patient avant tout acte de soins, ceci dans un souci évident de sécurité du patient, afin de garantir que tout acte de soins soit délivré au bon patient. Parmi les contextes critiques figurent le bloc opératoire, la préparation, la délivrance et l’administration des traitements, ainsi que la réalisation de gestes médicaux à risque. Les situations où le patient ne peut pas communiquer, ainsi que les transferts de patients, nécessitent une attention particulière. Cette phase comprend également l’identification des différents supports, tels que les prélèvements, les résultats d'analyses, les pièces du dossier patient, y compris les dossiers informatisés.
Gestion documentaire
Un système de gestion documentaire est un outil informatique permettant de stocker, organiser, gérer et diffuser l'ensemble des documents de l'établissement. Ces documents peuvent inclure des protocoles de soins, des procédures administratives, des notes de service, des politiques de confidentialité, des résultats d'audits ou des manuels techniques, entre autres. Toutes les procédures liées à l’identitovigilance doivent être diffusées et archivées dans la base documentaire de l’institution, accessibles par tous et mises à jour chaque fois que nécessaire.
Pour rappel, un système de gestion documentaire permet de :
- Stockage centralisé : Tous les documents sont regroupés en un seul endroit, évitant la dispersion de l’information et rendant leur gestion plus simple et plus efficace.
- Accès contrôlé : Les utilisateurs peuvent accéder aux documents en fonction de leurs habilitations. Par exemple, certains documents ne seront accessibles qu’aux médecins, d'autres aux gestionnaires ou aux administrateurs.
- Mises à jour : Le système permet de gérer différentes versions d'un document, avec un suivi des modifications et une mise à jour régulière pour garantir que le personnel accède toujours à la dernière version valide.
- Recherche facilitée : Le personnel peut rechercher des documents rapidement à l'aide de mots-clés, de catégories ou de critères spécifiques, évitant ainsi les pertes de temps dans la recherche d’informations critiques.
- Archivage : Les documents obsolètes ou inactifs peuvent être archivés pour des consultations futures ou des audits, tout en réduisant l'encombrement des informations courantes.